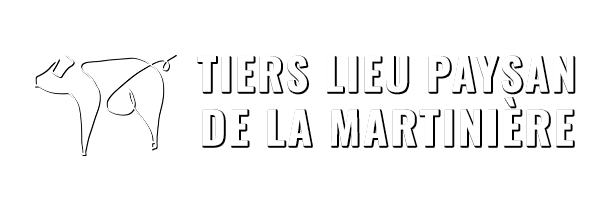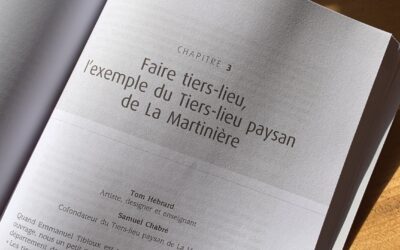Propos recueillis par Clément, membre du collectif du tiers-lieu paysan de la Martinière et acteur au sein d’une expérimentation de caisse de sécurité sociale de l’alimentation, au pied du Vercors, dans la Vallée de l’Isère lors de la conférence du 23 mai 2025.
On ne pouvait pas passer à côté du sujet de la « Sécurité sociale de l’alimentation » (SSA) — désormais discutée jusque dans l’hémicycle. Elle fait partie de ces projets politiques qui nous redonnent de l’espoir, par sa portée radicale autant que par les réponses concrètes qu’elle apporte à la précarité agricole et alimentaire.
Derrière la cinquantaine de groupes locaux qui s’en réclament, une idée aussi simple que révolutionnaire : appliquer à l’alimentation les principes fondateurs de la sécurité sociale de 1946, avant son long démantèlement par les politiques néolibérales. Il ne s’agit pas seulement de mieux consommer, mais de transformer l’ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation. Demain, on pourrait, muni d’une carte vitale de l’alimentation, accéder à des produits conventionnés remboursés — comme on le fait pour les soins médicaux — via des caisses locales autogérées, administrées démocratiquement par les citoyen·nes, qui en fixeraient le niveau de cotisation sociale et le montant d’allocation alimentaire (environ 150 € par mois).
« Ce projet veut redonner aux citoyens le pouvoir de gérer collectivement une caisse commune pour choisir leur alimentation, de manière démocratique. »
Si ces expérimentations paraissent encore éloignées d’une généralisation, elles posent néanmoins la question de comment nous organiser collectivement pour garantir l’accès à une alimentation de qualité, choisie, à toutes et tous ? Comment dépasser cette contradiction criante où seuls les plus aisé.es peuvent aujourd’hui y prétendre ? Et comment associer pleinement les agriculteurs, souvent marginalisé·es de ces réflexions, ainsi que l’ensemble des travailleur·euses invisibilisé·es de la filière comme du quotidien — ouvrier·es de l’agroalimentaire, artisan·es, cuisinier·es, habitant·es des quartiers populaires, les femmes… — qui nous ramènent aux oppressions systémiques plus profondes, qu’elles soient sociales, de genre ou raciales ?
C’est pour creuser ces tensions, ouvrir des perspectives et ancrer le débat dans le réel, que nous avons organisé cette discussion à la Ferme de la Martinière, dans le cadre d’un cycle de conférences. Avec Dominique Paturel, chercheuse, militante et co-autrice de Manger. Plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation (2021), et Rémy Léger, cofondateur de la Ferme des Volonteux, membre de l’Atelier Paysan et des Fermes Partagées.
D’où ça vient, toutes ces expérimentations autour de la SSA, et qu’est-ce qu’elles racontent ?
Dominique : Ce qu’on appelle aujourd’hui « expérimentations de sécurité sociale de l’alimentation », ce n’est pas encore la SSA, soyons clairs. Parce que le cœur du modèle, la cotisation sociale – autrement dit, le financement collectif par répartition –, n’existe pas encore. Ce pilier-là, seul l’État peut le mettre en place. On ne décrète pas une sécurité sociale à l’échelle d’un quartier ou d’une commune.
Mais toutes ces expériences locales, ce qu’elles ont en commun, c’est qu’elles tracent une direction. Elles posent des pierres pour ce qu’on pourrait construire demain. Et surtout, elles ne surgissent pas de nulle part. Ce mouvement, il a déjà plus de 20 ans. On peut remonter au début des années 2000, avec la naissance des premières AMAP en France. Ce sont d’abord des citoyens qui commencent à se demander ce qu’ils mangent, et ce qu’ils soutiennent en choisissant tel ou tel produit. Très vite, ils posent une exigence politique : soutenir une agriculture qui respecte les paysans et les territoires. À l’origine, le collectif pour la SSA est né de cette double tension : le soutien à l’agriculture paysanne d’un côté, et la lutte contre la précarité alimentaire de l’autre. Deux combats qu’il ne faut surtout pas opposer, mais au contraire articuler. Dès le départ, des réseaux comme la Confédération paysanne ou les Amis de la Conf’ sont là pour porter cette articulation.
Mais très vite, on comprend que parler de système alimentaire, ce n’est pas juste parler des agriculteurs et agricultrices – aussi centraux soient-ils. Un système alimentaire, c’est aussi les transformateurs (comme les boulangers), les distributeurs (et pas seulement Biocoop, hein – dans beaucoup de territoires, c’est Intermarché ou Super U), et les lieux où l’on mange : la maison, la cantine, le resto, la rue. Donc quand on dit “sécurité sociale de l’alimentation”, c’est tout ça qu’on embarque. Et c’est là que ça devient à la fois passionnant et complexe.
Aujourd’hui, on voit apparaître deux grands types d’expérimentations. D’un côté, des démarches portées par des collectifs de consommateurs, qui travaillent surtout sur le conventionnement : quels produits sont “conventionnés”, sur quels critères, avec quelles valeurs ? De l’autre, des initiatives qui associent plus directement les producteurs, souvent autour de marchés repensés pour intégrer à la fois l’accès et la juste rémunération. Mais on voit bien qu’il y a encore de la place pour imaginer d’autres types d’expérimentation, des expériences politiques qui échappent aux logiques dominantes et résistent à leur récupération institutionnelle ou néolibérale.

Même si vous ne vous réclamez pas de la Sécurité sociale de l’alimentation, en quoi cette idée rejoint-elle votre projet collectif à la ferme des Volonteux ?
Rémi : A vrai dire, moi je n’y connais rien à la SSA.. Mais quand j’en entends parler, je me dis qu’on fait déjà un bout de ce chemin-là. À la base, notre projet de ferme, c’était déjà ça : faire ensemble, mutualiser les outils, construire une protection sociale à notre échelle, inventer un métier collectif. Être intelligent à plusieurs, quoi. Aujourd’hui, on est une dizaine d’associés, une vingtaine de personnes en tout. On fait du maraîchage, de l’arboriculture, des céréales qu’on transforme en farine, puis en pain. Il y a de l’élevage, une pépinière, une herboristerie, un magasin, de la pédagogie… Et franchement, la solidarité, j’ai l’impression que c’est le cœur de notre métier de paysan. Qu’on appelle ça SSA ou autrement, au fond, on est branchés sur plein d’initiatives qui vont dans le même sens. La bataille, elle est là aussi : comment on transforme un territoire à partir de l’agriculture.
Ce que je trouve fort dans la SSA, c’est qu’on remet l’alimentation au centre de la société. On redonne aux citoyens la main sur un truc fondamental : ce qu’ils mangent tous les jours. Ça leur fait prendre conscience que l’alimentation, c’est ce qui les fait tenir debout au quotidien. Mais pour nous, paysans, c’est aussi une reconnaissance. Parce que notre système, aujourd’hui, il ne sait pas payer décemment des gens qui nourrissent tout le monde. Il ne sait pas reconnaître que « l’alimentation, c’est aussi de l’écologie » — et que cette écologie-là, ce sont les paysans qui la portent. On protège la ressource en eau, la biodiversité, on produit pour les autres… et à la fin, on a des salaires de misère. C’est ça, la réalité. Moi je suis un prolo. On est vingt prolos à produire de l’alimentation pour des CSP+. Ce que la SSA permet d’imaginer, c’est un retournement de ce système. Ça remet les paysans au cœur de la machine, comme des acteurs à part entière de la société. Et ça, franchement, ça donne envie.
Est-ce qu’il y a, selon vous, un vrai projet politique derrière la SSA ? Et qu’est-ce qu’il implique ?
Dominique : Ce que révèlent les expérimentations locales de SSA, ce n’est pas tant une révolution immédiate du système alimentaire qu’un processus de politisation lente et profonde. On y voit des groupes qui apprennent à décider ensemble, à partir de leurs besoins, dans une logique de démocratie du quotidien. Et dans une période où les espaces de délibération collective se réduisent, cette capacité à se réapproprier des enjeux aussi concrets que l’alimentation est précieuse. C’est déjà un geste politique.
Mais la SSA ne se limite pas à la démocratie locale. C’est aussi une proposition politique forte, qui réouvre frontalement la question du travail dans l’alimentation. À travers le conventionnement, on interroge non seulement ce qu’on mange, mais dans quelles conditions sociales, économiques et humaines cette alimentation est produite. Ça oblige à faire dialoguer des mondes qui ne se parlent pas toujours : agriculture paysanne et conventionnelle par exemple. Et à prendre au sérieux les inégalités au sein même des filières, de faire converger des intérêts parfois opposés. Un vrai enjeu consiste à intégrer les salarié·es de l’agro-industrie dans ces projets, et pas seulement les petits producteurs en circuits courts.
La SSA, c’est aussi une manière de poser frontalement la place des femmes dans le système alimentaire. Parce qu’aujourd’hui encore, l’alimentation repose largement sur le travail invisible des femmes, dans les foyers, les cantines, les ateliers de transformation. Transformer l’alimentation, c’est donc aussi reconnaître ces savoirs, ces vécus, et leur donner un rôle central.
Enfin, il faut le dire clairement : les classes populaires restent largement absentes des dynamiques SSA, et c’est un vrai problème. Les groupes moteurs de ces expérimentations sont souvent composés de classes moyennes urbaines, diplômées, qui — même de bonne foi — projettent leurs normes alimentaires : manger moins de viande, plus de légumes, moins gras, plus local qui entrent parfois en conflit avec des cultures populaires ancrées. Si on ne veut pas reproduire, dans les alternatives, les mêmes mécanismes de domination, il faut se confronter à cette diversité des rapports à l’alimentation, sans les hiérarchiser.
C’est pour ça que la SSA ne peut pas se contenter de bienveillance citoyenne ou de gouvernance technique. Elle suppose d’inventer une nouvelle architecture démocratique, avec de vraies assemblées populaires, où l’on ferait une place explicite à des paroles invisibilisées : une assemblée des femmes, pour faire valoir ce que l’alimentation quotidienne mobilise d’inégalités de genre ; une assemblée des enfants, pour poser les enjeux sur le long terme.
Très concrètement, quelles sont les conditions pour mettre en œuvre cette SSA ? Et surtout, comment faire pour ne pas laisser les paysans de côté ?
Rémi : Ce qu’il faut dire d’entrée de jeu, c’est que dégager du temps pour s’engager, c’est compliqué, même sur une ferme collective. Quand je m’absente, ce n’est pas neutre : soit le boulot ne se fait pas, soit ça retombe sur les collègues. Donc, là où on peut participer, c’est quand c’est rémunéré, quand on a un modèle économique qui reconnaît ce temps comme du vrai travail. Et ça, c’est une conviction que j’ai : les fermes collectives, si elles sont bien pensées, peuvent permettre ça. Elles peuvent faire émerger ce que j’appelle des paysans politiques : des paysans soudeurs, biodiversité, formateurs, animateurs… des paysans qui produisent, mais aussi qui prennent part aux transformations du territoire. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ces rôles-là soient intégrés dans le cœur du projet de SSA, pas en périphérie.
Et puis, il faut aussi reconnecter à l’ensemble du monde agricole : on ne changera rien si on reste enfermés dans des oppositions stériles, du type bio contre conventionnel, ou petits contre gros. Beaucoup d’agriculteurs “conventionnels” ont juste répondu aux injonctions du système : produire plus, standardiser, rentrer dans les cases. Ce ne sont pas eux les coupables. C’est la société qui leur a dit de faire comme ça. Et aujourd’hui, si on veut construire une autre voie, il faut aller à leur rencontre, ouvrir le dialogue. Pas en mode « donneur de leçons », mais avec respect. Parce qu’au fond, on fait tous le même métier, et au bord du champ, on vit les mêmes problématiques : sécheresse, revenu insuffisant, isolement, pression économique.
Il y a ce chiffre, du rapport du Shift Project : 80 % des 7000 agriculteur.ices interrogé.es disent être prêt.es à changer de modèle. Mais ils ne le feront pas juste parce qu’on leur dit que c’est mieux. Ils ont besoin de garanties, de conditions, d’un accompagnement. Si tout ce qu’on leur tend, c’est de la culpabilisation ou de l’injonction, ils se ferment. Par contre, si on leur montre que des alternatives comme la SSA peuvent améliorer leurs conditions de vie, les respecter, les comprendre, alors là, oui, ça bouge. Et c’est aussi un appel aux citoyens : ouvrez le dialogue, même avec ceux qui traitent, même avec les gros. Parce que sinon, le lien est déjà rompu.
Dominique : Et puis soyons clairs : on ne nourrira pas toute la population uniquement avec de l’agriculture paysanne. On peut le regretter, mais c’est une réalité. Donc la question, ce n’est pas « pour ou contre l’agro-industrie », c’est comment on transforme démocratiquement ce qui existe. Comment on se donne des espaces où on apprend ensemble, collectivement, à penser un autre modèle. Parce qu’aujourd’hui, on ne se parle plus entre mondes agricoles, et c’est un vrai blocage.
Je te rejoins sur cette espèce de « remontisme » autour de la figure du paysan. Ça peut être un frein. Parce qu’en centrant tout sur cette figure idéalisée, on oublie que l’agriculture a aussi d’autres fonctions, qu’elle a toujours été plurielle. L’agriculture paysanne, c’est une catégorie récente, moderne. Et parfois, elle devient un cadre trop étroit pour penser la transformation du système alimentaire. Il y a pourtant des moments où les luttes sociales et le monde paysan se sont rejoints. On l’a vu pendant les grèves, les soulèvements de la terre. Et même avant, sur les ronds-points des Gilets jaunes, la nourriture circulait, la solidarité s’exprimait par des cantines populaires. La bouffe dans les luttes, c’est vital. Mais aujourd’hui, peu de cantines militantes ont un lien direct avec des paysans. Il faut aller plus loin.
Donc dans le projet SSA, il ne s’agit pas juste de créer une caisse pour les consommateurs. Il faut aussi que cette caisse puisse investir dans la transformation agricole. Soutenir des outils de production, de transformation, de distribution, financer des infrastructures collectives. Ce rôle de levier politique et économique, il est central. Sinon, on reste à la surface.
Rémi : Oui, et des outils existent déjà. Les régies municipales, par exemple, c’est un levier énorme. Ce sont des structures agricoles gérées directement par les communes, qui permettent de produire en régie publique pour alimenter les cantines ou d’autres services collectifs (comme à Mouans-Sartoux, où la ville cultive en bio ses propres légumes pour les cantines scolaires). Ces régies permettent aux collectivités de s’impliquer concrètement, mais surtout, elle reconnecte la politique alimentaire à la terre, à la production, à la gestion du foncier. Très vite, on se rend compte qu’il n’y a plus de terres agricoles disponibles, qu’il faut protéger les zones nourricières, qu’il faut penser le prix juste. Et ça, ça change les représentations, ça pousse les élu·es à penser autrement. Ce sont des vraies dynamiques de transformation locale, qui peuvent faire basculer des territoires entiers.
Conclusion
✊ on fait quoi là
Ce que racontent les expérimentations autour de la Sécurité sociale de l’alimentation, c’est bien plus qu’un modèle à répliquer : c’est un appel à reprendre collectivement la main sur ce que nous mangeons, sur ce que nous produisons, sur les formes d’organisation démocratique que nous voulons expérimenter. À la croisée des luttes sociales, paysannes et écologistes, la SSA dessine une perspective politique forte : reconstruire un système alimentaire juste, géré par et pour celles et ceux qui le font vivre au quotidien.
Et pour que cette ambition prenne corps, nous avons besoin de lieux, de caisses citoyennes, de fermes collectives, de syndicats. D’habitant·es qui s’organisent localement. De paysan·nes qui s’émancipent. De cuisinier·es, de distributeur·rices, de mangeur·euses, d’élu·es qui osent poser les bases d’un autre contrat social autour de l’alimentation.
Alors si vous souhaitez vous engager, expérimenter, soutenir :
- LOCALEMENT 👉 bientôt à Roanne ou dans la Loire Nord ? Réunissez un petit groupe avant de vous lancer… ou aller rencontrer le plus proche déjà constitué 👉 Saint Etienne
- 👉 À l’échelle nationale, toutes les ressources, actualités et cartographie des groupes sont disponibles sur le site du Collectif pour une SSA :
🌐 Collectif nationale pour une Sécurité sociale de l’alimentation
🗺️ La carte des dynamiques locales
- 🌾 Soutenir des fermes collectives :
- 🛠️ Pour aller plus loin dans les pratiques :